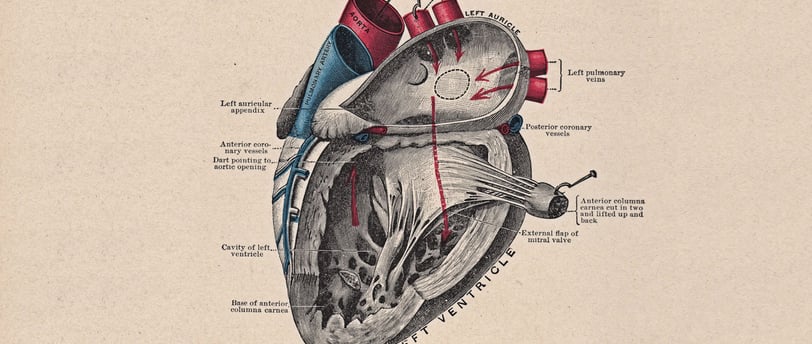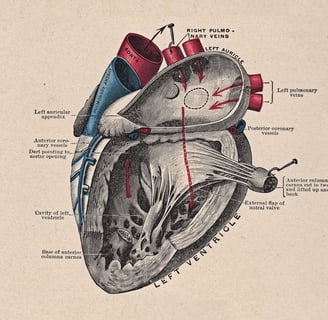Pourquoi tombé-je malade ?
TOUT est communication
4 min read
Pourquoi tombé-je malade ?
Le ciel est bleu et le soleil brille, les rues sont bordés de palmiers et de conifères, on croirait un paysage nord-californien comme décrit par Kerouac. Ce qui tombe bien puisque nous y sommes effectivement, plus précisément sur le campus de Standford, subtil mélange entre une architecture gothique digne d’Oxford et le style adobe des villes mésoaméricaines. C’est ici que dans les années 50 a été fondé un courant de pensée nommer l’école de Palo Alto, du nom de la commune sur laquelle se tient ce campus.
En 1967, Watzlawick, Beavin et Jackson compulsent les écrits de leur maître Gregory Bateson pour établir cinq axiomes qui fondent toute communication, dits des cinq axiomes de Watzlawick :
- Axiome d’impossibilité : On ne peut pas ne pas communiquer, tout comportement vaut communication
- Axiome d’englobement : Toute communication présente deux aspects : le contenu et la relation ; tel le second englobe le premier pour se faire méta-communication.
- Axiome de double nature : Toute communication utilise deux modes : le numérique et l’analogique, c’est-à-dire verbal et non-verbal
- Axiome de réciprocité : Toute communication est symétrique ou complémentaire, selon qu’elle soit fondée sur l’égalité ou la différence
- Axiome de ponctuation : La nature d’une communication dépend de la ponctuation de la séquence des faits.
Concentrons-nous ici sur le plus puissant de tous, le premier des cinq.
Actes manqués
C’est au début du dernier chapitre de sa Psychopathologie de la vie quotidienne que Freud annonce l’hypothèse qu’il défend, à savoir qu’il existe, dans notre comportement, des insuffisances du fonctionnement psychique, a priori non-intentionnels, mais qui se révèlent être motivées par notre inconscient. Il les nomme « actes manqués ». Ce sont les oublis, les erreurs, les lapsus, les méprises et les actes accidentels. On en trouve une définition au chapitre 11, ce sont deux tendances, l’une inconsciente et parasitaire et l’autre consciente et dominante, qui interagissent en un compromis qu’est l’acte manqué lui-même, résultante symptomatique de la lutte entre elles deux.
Tous les actes manqués, graves ou légers, se ramènent à des matériaux psychiques incomplètement refoulés et qui, bien que refoulés par le conscient, n’ont pas perdu toute possibilité de se manifester et de s’exprimer. Deux domaines permettent de mettre en exergue les motivations inconscientes des actes manqués : le premier est de l’ordre de la pathologie, comme chez le paranoïaque, plus ordinaire est deuxième domaine, la superstition.
L’oubli
Freud attribue une place importante au processus de l’oubli, un des actes manqués les plus fréquents, en en dressant ainsi une description mécanique : c’est un processus spontané avec une certaine durée et où une sélection s’opère parmi les diverses impressions des évènements vécus et parmi les détails de ces impressions. Freud repousse l’hypothèse qui attribue l’oubli à des causes neurophysiologiques seules, arguant qu’à circonstances variables ne peut s’appliquer un mécanisme uniforme. Mais il admet aussi que la fatigue, des troubles circulatoires ou une intoxication peuvent le favoriser. Or, il y a des conditions à remplir pour qu’un stimulus reste en mémoire, et en l’absence de l’une d’entre elles, l’évènement est oublié.
Freud énonce alors son hypothèse sur l’origine des oublis, comme quoi cette faculté peut être motivée par le besoin de gommer un sentiment désagréable. Cette tendance à oublier ce qui est pénible n’est nullement dépendantes des capacités mnésiques. Via un exemple rapporté par Ferenczi, l’oubli servirait en dernier lieu à ne pas succomber à un désir impulsif. Bref, l’oubli serait donc un processus par lequel un motif est, en premier lieu, empêché de s’exprimer, d’où cette remarque choc : « tout ce qu’on considère comme oublié ne l’est pas ».
Freud donne le nom « d’instinct de défense » à l’oubli d’évènements pénibles. Mais il concède qu’il n’est pas tout puissant et ne peut donc intervenir chaque fois, il s’incline face à des forces psychiques plus puissantes. Dans la hiérarchie architectonique de l’appareil psychique, au sein de cette stratification d’instances, l’instinct de défense fait partie des instances inférieures et peut donc être entravé dans son actions par les instances supérieures. Il a tout de même une force propre, qui peut justifier un déplacement. Si un fait ne peut être oublié, un déplacement s’opère et c’est un autre élément annexe qui est alors oublié, tant que celui-ci est relié de quelque façon que ce soit à la chose principale. Comme le préconisait Nietzsche, la mémoire cède face à l’orgueil.
Bénéfice secondaire de la maladie
La manifestation la plus étrange et extrême des actes manqués est quand ils servent de châtiment qu’on s’impose à soi-même, une chute ou casser un objet, par exemple, peut être une manifestation névrotique. Il existe donc un sabordage mi-intentionnel motivé par une intention inconsciente mais déguisé en accident. Le prétexte est ici le soulagement psychique quant à ses causes réelles.
L’expression « bénéfice de la maladie » exprime bien cette situation. Mais il ne faut pas se tromper, bénéfice ne signifie pas tant avantage que soulagement. Il faut aussi faire une distinction entre le bénéfice primaire pour le Moi lors de l’apparition du symptôme, et ce bénéfice secondaire qui résulte de ce que le symptôme est obligé de se combiner à d’autres intentions du Moi, par étayage. C’est-à-dire que le motif d’être malade est parfois la visée d’obtenir un bénéfice qui vient alors aider à ce que le symptôme s’intègre dans le Moi.
Freud indique qu’il existe cinq sortes de résistances dans l’analyse : le refoulement, la résistance de transfert, la résistance de l’inconscient, celle du Surmoi et ce bénéfice de la névrose. Il va plus loin, dans ses Conférences d’introduction à la psychanalyse : « Quand une organisation psychique du type de la maladie a existé pendant un laps de temps assez long, elle finit par se comporter comme un être autonome ; elle manifeste quelque chose comme une pulsion d’autoconservation, il se constitue une sorte de modus vivendi entre elle et d’autres parties de la vie psychique, même celles qui lui sont au fond hostiles, et il ne peut guère manquer que se présentent des occasions dans lesquelles elle acquiert en quelque sorte une fonction secondaire, qui redonne vigueur à son existence. »
Contacts
Adresse : 5, rue des Viollières, 69630 CHAPONOST
Adresse : 107, avenue de Verdun 69330 MEYZIEU
Tel : 06.31.37.15.51
Mail : stephane.monachon@gmail.com
Réseaux sociaux
- Horaires d'ouverture -
Chaponost :
Mardi : 9h - 20h30
Jeudi : 9h - 20h30
Vendredi : 9h - 20h30
Meyzieu :
Lundi : 9h - 20h30
Mercredi : 9h - 20h30
Samedi : 9h - 20h30